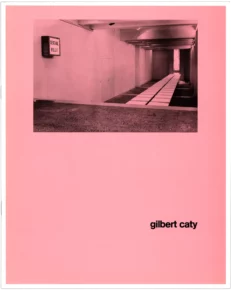16.02.88 – 19.02.88
Gilbert Caty
Sexual Folly


Commissariat : Axel Huber
Le degré haine + 1 de la peinture
Les grandes explorations géographiques de la surface de la Terre s’achèvent – ou presque – beaucoup plus tard qu’on ne le pense ordinairement ; plus précisément entre 1909, l’année de l’expédition Peary au pôle Nord, et 1911, celle de l’expédition au pôle Sud d’Amundsen.
On est en pleine effervescence futuriste, sur le point de constater que les grandes explorations des modes de représentation sont, elles aussi, en voie d’achèvement.
Gilbert Caty est le petit-fils de cette conscience-là, moins un héritier de Duchamp que de Toroni. C’est à ce dernier qu’il doit la radicalité de son identité de peintre, un format de cinquante centimètres sur cinquante centimètres, à l’intérieur duquel tout peut être art et lui appartenir, jusqu’à la peinture d’autres artistes qu’il sollicite à côté de son travail personnel au fur et à mesure des rencontres, et qu’il collectionne. A ceux qui objecteraient qu’un carré de cinquante centimètres de côté est un bien petit asile pour un projet si ambitieux, on pourrait opposer deux arguments. D’une part que la banalité même de ce format, son échelle mollement moyenne, son déguisement d’échantillon, ne sont pas sans le proposer à un statut plus général : une norme ambiguë entre la réalité du pré carré très petit et la représentation du plan de la ville, une surface exacte qui serait la place d’un droit de cité permanent, un lieu dont le spectaculaire serait a priori exclu, un peu comme la rapidité de l’exécution des pièces d’Armleder lui interdit le recours à l’effet. Et d’autre part cette idée que l’asile est souvent d’autant plus juste que les périls, à l’extérieur, sont plus grands. On pourrait ainsi dire qu’à l’instar des Esquimaux qui vont répétant de place en place, dans un milieu hostile, le même igloo qui abrite leurs ébats et leurs enfants, Gilbert Caty répète le format qui autorise la liberté de son travail et son inscription dans la culture.
Thèmes, occasions, fatigues, expériences, techniques, réminiscences, imitations, naïvetés, sens, maladresses, émotions, courages, poésie… rien d’imaginable qui puisse échapper à ce format capable de la seule autorité de sa clôture de tout signer à nouveau.
C’est que, pour artificiel qu’il ait été dès l’origine, et c’est bien ainsi qu’il se donne toujours à percevoir aujourd’hui, ce propos ne s’en est pas moins révélé d’une exigeante perversité. Certes, il s’agit d’abord de la production de l’art, mais aussi, compte-tenu du processus qui fait accéder à ce statut tout ce qui sera inscrit dans le format prévu, d’un lexique qui ne donnerait à chaque élément de son vocabulaire sa pleine identité que par son achèvement : une langue aux paroles imprononçables, muette de l’équivalence de ses mots, la visite en alexandrins mesurés et monotones d’un musée d’autant moins imaginaire qu’il serait exhaustif.
Et c’est ce que l’on a pu voir d’abord dans le travail de Gilbert Caty, l’exposition de fragments du paradigme, composés de séries de pièces dont le vague et aléatoire ordonnancement se prêtait à rendre visible en premier lieu le caractère mécanique de la production.
Quelques accrochages plus tard, cependant, le paradigme, comme une affection plus mûre, laissait apercevoir ses premiers syntagmes, l’impossibilité de rompre tout-à-fait avec le sous-entendu d’un choix des n’importe-quoi d’élite plus pressés que les autres d’entrer dans la collection à jamais impossible à clore ; le système lui-même revendiquant son rang dans l’histoire se désignait à la fois comme tout et partie, synecdoque mutante, à peine balbutiée et déjà monstrueuse.
Les expositions de Gilbert Caty se construisent aujourd’hui sur le reflet de ce paradoxe. L’allusion, sifréquente dans l’art contemporain, s’y fracture entre ce que chaque pièce produite reproduit de culture et ce que chaque ensemble exposé s’expose à produire de sens. II faudrait parler de « paratagme » pour dire les rigueurs très particulières d’une situation dans laquelle langue et parole sont volontairement confondues, où les règles de la grammaire sont superposées aux phrases du discours, où l’explosion du discours individuel implose dans le dictionnaire.
Aussi le travail réel de Gilbert Caty est-il peut-être moins composé des pièces carrées de cinquante centimètres de côté qu’il accumule, que des accrochages et des expositions qu’il réalise et dont les toiles sont comme autant d’unités presque discrètes, sans signification réellement autonome. Au-delà des allusions tues au quotidien et au caprice des jours, sa production semble trouver de plus en plus son origine dans les lieux où elle se manifeste, justifier le choix des fragments qui désignent l’impensable ensemble par les jeux, au sens propre locaux, qui peuvent en éponger chaque fois l’excès de sens. C’est dans la recherche de l’équilibre rigoureux de ces installations où l’un et l’autre se superposent que le regard devine à la fois, comme sur une radio-graphie, le particulier et le général, la vie anecdotique et transparente des chairs et la mort anonyme et opaque du système du squelette, image close des relations de l’artiste à son temps. Gilbert Caty dit : « Le degré haine + 1 de la peinture ».
Jean-Philippe Vienne