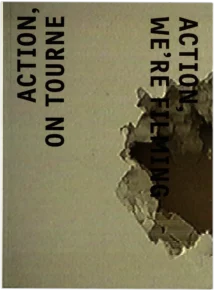31.03.01 – 10.06.01
Endtroducing














Avec: Stan Douglas, Christoph Draeger, Douglas Gordon, Mark Lewis, Constanze Ruhm, Fiona Tan, Vibeke Tandberg, Philippe Terrier-Hermann
Commissariat : Laurence Gateau
Endtroducing : traduire : c’est quand ça finit que ça commence ; question de perspective : le crépuscule est une aurore, en cours. Infinie mise en boucle donc, cercle vicieux, looping for ever ? Non, plutôt ce qu’une famille d’artistes de la même génération fait comme constat :
1. Lointain héritier des pièces télévisuelles de Beckett, le travail de Stan Douglas explore les possibilités narratives issues, ainsi qu’il l’explique, « d’une subjectivité incertaine ». Ce flottement de l’énonciation exige pourtant un très grand calcul qu’expose chaque fois différemment chacune de ses pièces. Mais, loin d’être une ruse pauvrement formaliste, cette sophistication d’élaboration, à laquelle fait écho la rigueur de la monstration, est la condition et le signe de leur ouverture maximale ; en direction, par exemple, de préoccupations politiques. Érudite (ici Der Sandmann, inspiré d’un conte éponyme d’Hoffmann, L’Homme au sable, interprété en son temps par Freud ; le tout confronté à l’invention des jardins ouvriers) et consciente à l’extrême des enjeux des supports utilisés, son œuvre marie d’une habileté bouleversante une pratique aiguë de la déconstruction avec une approche mélancolique du rapport au passé.
2. Désastres, catastrophes sont les événements sur lesquels se construisent les œuvres de Christoph Draeger. Catalogue raisonné des icônes des apocalypses au quotidien (accident d’avion, tremblement de terre, raz-de-marée, extraits violents de « films d’action », etc.), son œuvre photo ou vidéo recense ces déflagrations qui trouent les images de l’information. C’est autour du paradoxe de leur évidence, au cœur de laquelle, disait Jabès, il y a le vide, que joue l’artiste : fascinantes dans leur caractère impérieux d’autorité sans détours, meurtrières dans leur rapport à l’espace et au temps (elles les suspendent indéfiniment), ces vignettes mythologiques seraient la forme exponentielle de notre horizon désormais dévasté. Saturer d’un néant magnifié la nullité de notre imaginaire (nos possibles), voilà l’entreprise de révélation (étymologie, comme chacun sait, de l’apocalypse) de ce Zurichois, arrière petit-fils désenchanté des énervés du Cabaret Voltaire.
3. Partisan de la littéralité, comme déjà Bruce Nauman, Douglas Gordon se distingue par la violente efficacité avec laquelle il s’approprie ses objets d’élection. Redoublant une séquence de film mythique (Through the looking glass dédoublant un extrait de Taxi Driver), étirant un film entier sur le temps supposé de sa narration (La prisonnière du désert ralenti sur cinq ans), ou sur une journée entière (Psycho), etc. (la liste est longue et l’artiste prolixe), cet Écossais de Glasgow fait payer cash l’héroïsme dont est crédité l’empire cinématographique. Ce qu’il restitue ainsi au spectateur ? Sa place, mobile, monstrueuse ; mais dans son espace et dans son temps, c’est-à-dire son commun, le nôtre. Descendus sans manière de leur piédestal, soumis à la myopie analytique, les films ainsi malmenés retrouvent une seconde beauté (voire une première), celle d’entrer, innocents, moins dans le panthéon de nos fantasmes inaccessibles que dans notre réalité déjà indissociable de ses images.
4. Marqué peut-être par son homonymie avec le trouble héros du film culte de Michael Powell, Peeping Tom (Le Voyeur) auquel il rend ici hommage, Mark Lewis, artiste canadien, proche de Victor Burgin et de Jeff Wall, a choisi dans les années 90 d’élaborer ce qu’il appelle le part cinema : cinéma en pièces. « Ni expérimental, ni figuratif, ni contre l’art du récit ou le simple fait de raconter des histoires », précise-t-il, son travail vise à se saisir du film au moment où celui-ci, cédant sa place hégémonique comme art de masse au profit des nouvelles technologies, commence déjà à se survivre. Cette survie, fastueuse et ruinée, l’autorise à l’autopsier et à le produire sous la forme de précieux morceaux d’anthologie. Perplexes, morcelés et jouissifs, ses « films » ambitionnent de dépasser le clivage caduc du cinéma expérimental et du cinéma radical commercial. Débarrassés du dispositif régressif de la salle obscure et des « séances », ils revendiquent la pleine mise en lumière et la curiosité déambulatoire. Assumer une telle maturité, en dépit de sa sanction d’inactualité, signale le statut, selon lui toujours tardif, d’art, offrant l’infinie liberté formelle qui accompagne toujours semblable sagesse.
5. Nul ne s’étonnera que Fiona Tan, née en Indonésie d’une mère chinoise et d’un père australien, élevée dans le pays paternel et habitante aujourd’hui des Pays-Bas, fasse de l’identité le noyau obscur de son travail. Encore définit-elle cette identité d’une singulière façon : « une mémoire que l’on ne cesse de perdre ». Pareille mise en garde tranche avec l’emphase des gestes sociologiques des propriétaires de tout poil : c’est un manifeste du dessaisissement, où le cinéma, instrument privilégié de son investigation, joue le rôle, selon ses mots, d’« une invention des morts ». Usant d’une dramaturgie de type documentaire qui mêle images d’archives et plans tournés, elle met exemplairement à nu notre lent devenir collectif de denizen, ce résident non-citoyen, être en exode (même immobile) , tel qu’Agamben en prophétise l’imminence. Non pas des refuges identitaires et glorieux ; à l’inverse : les images de ses films nous rappellent à notre nouvelle fragilité, celle de perpétuels réfugiés dans de très étroites cités (Thin Cities) avec, pour tout bagage, le maigre secours d’une mémoire défaillante.
6. Vibeke Tandberg est plusieurs. Si son registre paraît prisonnier de la « sphère de l’intime », puisqu’elle décline ses clichés en obéissant au cadre sévère de l’album de famille, c’est pour mieux faire imploser cette pauvre boule de cristal. Dans la lignée de C. Boltanski, S. Calle ou C. Sherman, cette artiste norvégienne fait jouer les puissances évocatoires de l’image contre elles-mêmes : c’est là où ça ressemble que ça fait mal – pourquoi ? Parce que c’est creux. Par les moyens de la photographie ou du film, qui sont exploités d’abord dans leurs capacités de trucage, Tandberg se clone, s’invente une sœur jumelle sur Photoshop, une famille de visages produits de morphing, et une destinée sur argentique. On l’aura compris, la reproductibilité de la technique frappe en retour ce qu’elle reproduit : nous sommes le fruit de nos représentations, et celles-ci le produit de nos prothèses technologiques. Nous reste à nous contempler, parfaits inconnus, extraterrestres habités de quelques tics, exclusifs et maigres signes de reconnaissance.
7. Constanze Ruhm se souvient de films, mais elle ne transforme pas ces souvenirs en trésor ; au contraire, elle les dépeuple. Lucide, dans la tradition critique des réalisateurs qui lui donnent du grain à moudre (Godard, au premier chef, dont, par exemple, une séquence de Nouvelle Vague inspire Travelling), cette Autrichienne construit, à l’aide du cinéma, un théâtre de la mémoire contradictoire : les paysages et les architectures que ses photos et vidéos déroulent sont à la fois propriétés collectives et énigmes singulières. Leur unique point d’intersection est un corps absent, corps technique, celui de l’instrument de la prise de vue. C’est au rappel insistant de ce point de vue qui seul vient meubler de manière fantomatique les décors désertés des personnages et de leurs histoires que tout son travail s’attache : elle appelle cela Piece of Evidence (Pièce à conviction), qu’elle corrige aussitôt d’un Circles of confusion.
8. Possible magasin d’accessoires pour une adaptation européenne d’un roman de Bret Easton Ellis, Intercontinental est une installation in progress de Philippe Terrier-Hermann qui rassemble aussi bien des clichés, des films, du mobilier qu’une ligne de vêtements et une eau de toilette griffées au nom de l’artiste. À l’esthétique du « cru » qui sévit, à ses dires, dans la production photographique actuelle, l’artiste oppose l’univers codé du luxe et son imagerie fabriquée du bonheur à l’ère de la domination incontestée du capital. Dans une logique comparable à celle de Philippe Cazal, mais rétrécie au seul domaine de la jet set économique, Intercontinental interroge la complicité entre la fascination pour un idéal de la réussite et la réussite de la fascination des images. Dans ce jeu du chat et de la souris qui se donne des airs de Monopoly à échelle 1, tout le monde est donné gagnant ; c’est-à-dire : sous l’emprise d’un reflet.